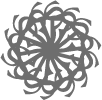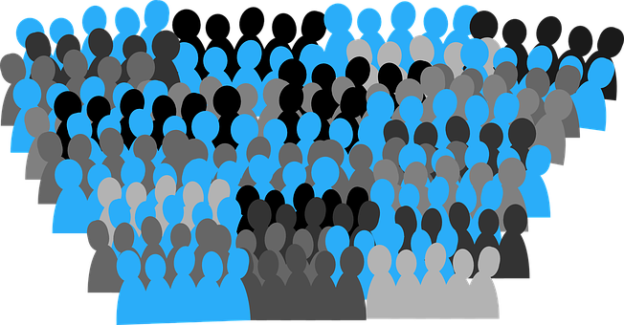Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), instauré par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, vise à répondre aux objectifs français et européens de baisse de la consommation d’énergie finale. Ce dispositif oblige les vendeurs d’énergies (tels qu’EDF, ENGIE, Total, etc.) à obtenir de leurs clients, professionnels et particuliers, la réalisation d’économies d’énergie en échange d’un certificat attestant d’un volume d’énergie épargnée.
Durant la première période du dispositif (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009), l’objectif national d’économies d’énergie était fixé à 54 milliards de kilowattheures cumac (54 TWh cumac). Eu égard aux résultats positifs de la première période, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a prorogé le dispositif (du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014). L’obligation pour cette deuxième période a représenté 447 TWh cumac.
Suite à l’objectif de réaliser chaque année des économies d’énergie équivalentes à 1,5 % jusqu’en 2020, fixé par la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, une troisième période du dispositif s’est ouverte (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017) avec un objectif d’économies d’énergie de 700 TWh cumac, soit une multiplication par 2 de l’ambition de la deuxième période.
Une quatrième période des certificats d’économies d’énergie a débuté le 1er janvier 2018. Pour cette nouvelle période, 1.600 TWh cumac devront être réalisés, dont 400 TWh à économiser auprès des ménages précaires.
Le dispositif des CEE permet, depuis la troisième période, aux producteur d’énergie de déléguer leurs obligations d’obtention de Certificats.
Suite à des cas de délégataires défaillants, le décret n° 2017-1848 du 29 décembre 2017 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l’énergie relatives aux certificats d’économies d’énergie (ici), a modifié certaines conditions de délégation.
Désormais, le délégataire doit justifier d’une délégation pour au moins 150 GWh cumac d’obligations reçues ou, à défaut, de l’existence d’un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d’économies d’énergie. Par ailleurs, le système de management de la qualité doit être conforme à la norme NF EN ISO 9001:2015 ou toute norme équivalente ou la remplaçant, certifié par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d’accréditation. Enfin, le volume de chaque délégation partielle ne peut être inférieur à 1 TWh cumac.