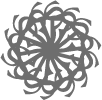Sébastien Lecornu a annoncé, à l’occasion de la 17ème Conférence des villes qui s’est tenue le 20 septembre dernier, la mise en place des contrats de transition écologique ainsi que la doctrine du Gouvernement en la matière.
Ces futurs contrats seront conclus entre l’Etat et, principalement, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) afin de créer des obligations réciproques « sur-mesure ». Il s’agira en effet de passer d’une logique d’appels d’offre auxquels les collectivités doivent s’adapter à un processus de rédaction concerté des contrats.
Le Gouvernement promet alors un accompagnement politique, technique et financier, le tout piloté par les préfets de département.
Autre nouveauté envisagée par le Secrétaire d’Etat près le Ministre de la Transition Energétique et Solidaire, une simplification des procédures environnementales pour les collectivités signataires d’un contrat de transition écologique.
Les modalités exactes de mise en œuvre de ces contrats seront alors annoncées lors de la prochaine Conférence des Territoires, en décembre 2017, pour une application sur le terrain prévue dès janvier 2018.